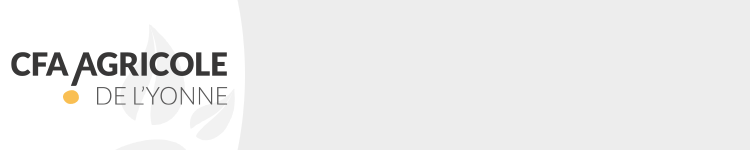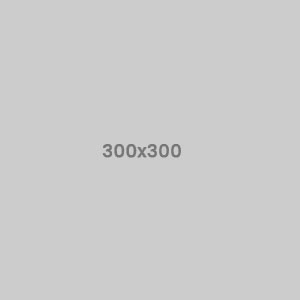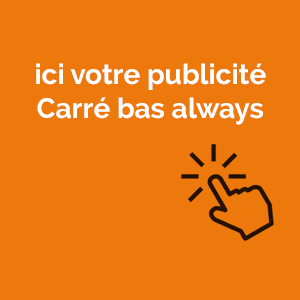Invité des "Conversations de l’Abbaye" : Jérôme FOURQUET radiographie une France en mutation accélérée (1/2)
 « Le directeur du département Opinion à l’IFOP, essayiste et analyste politique, Jérôme FOURQUET a fait salle comble à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre, à l’occasion de l’avant-dernier rendez-vous des fameuses « Conversations de l’Abbaye ». Il a livré un état des lieux édifiant et sans détour de la France contemporaine… ».
Crédit Photos : Dominique BERNERD.
« Le directeur du département Opinion à l’IFOP, essayiste et analyste politique, Jérôme FOURQUET a fait salle comble à l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre, à l’occasion de l’avant-dernier rendez-vous des fameuses « Conversations de l’Abbaye ». Il a livré un état des lieux édifiant et sans détour de la France contemporaine… ».
Crédit Photos : Dominique BERNERD.
A la fois directeur du département Opinion à l’IFOP, essayiste et analyste politique, Jérôme FOURQUET a fait salle comble à Saint-Germain, pour l’avant-dernier rendez-vous de la saison des « Conversations de l’Abbaye ». Livrant devant un public conquis, un état des lieux édifiant et sans détour de la France contemporaine. Entre désindustrialisation, consommation de masse et recomposition territoriale, c’est une société en perpétuel réagencement que l’auteur de « L’Archipel français » a dépeint, avec l’œil du statisticien, mais aussi la verve du conteur…
AUXERRE : « Comment sommes-nous passés d’une économie de la production à une économie de la consommation… ? ». Tout commence selon Jérôme FOURQUET au printemps 1992. En deux semaines à peine, la France bascule symboliquement d’un monde à l’autre. Le 31 mars, les chaînes de montage s’arrêtent à l’usine Renault de Boulogne-Billancourt. Mémoire ouvrière de la gauche française, l’icône industrielle devient un vestige. Moins de deux semaines plus tard, à Marne-la-Vallée, Mickey coupe le ruban d’Euro Disney, futur premier employeur mono-site du pays : « pas moins de 16 millions de visiteurs par an et pour les accueillir, Disney emploie sur ses deux parcs contigus, la bagatelle de 16 000 salariés ». La France de la production cède la place à celle du loisir et du service. Le glissement n’est pas anecdotique, mais total, massif et irréversible avec, de 2008 à 2020, plus de 940 sites industriels de plus de 50 salariés qui disparaissent. L’organisation de l’espace économique et social s’en trouve bouleversé : « une organisation symbolique sous forme de triangle, avec pour première pointe le site de production, pour seconde, la cité ouvrière construite par la direction de l’usine pour y loger les ouvriers et leurs familles et pour troisième pointe, le stade, de foot au nord, de rugby au sud… ». Et le même destin frappe l’agriculture, cette autre colonne vertébrale nationale, avec un nombre d’exploitations passant d’un million en 1988 à 380 000 exploitants aujourd’hui.
Les zones commerciales : nouveaux clochers des villes
Dans ce vide laissé par les moteurs historiques de l’économie, un autre modèle s’installe : grande distribution, logistique et e-commerce deviennent les piliers de la nouvelle société de consommation. Un exemple entre tous, celui d’Intermarché, dont l’expansion en quarante ans illustre un quadrillage sans faille du territoire, passant de 310 magasins en 1980 à plus de 1 800 aujourd’hui : « deux ouvertures par semaine, une présence moyenne d’un magasin tous les 14 km… ». En quelques décennies, « les Mousquetaires » et leurs concurrents ont transformé le pays en une gigantesque zone de chalandise ironise le directeur de l’IFOP : « tout cela a donné naissance à un élément paysager que le monde entier nous envie, les zones commerciales ! ». Un élément pourtant devenu incontournable : « quand on est en responsabilité dans le 7ème arrondissement parisien, on n’en a pas forcément conscience mais la zone commerciale, c’est le cœur battant de la société française, où 70 % du commerce s’effectue ». Un autre secteur est déjà en train de prendre le relais, celui de l’e-commerce, passé d’un chiffre d’affaires en 2005 de 8,4 milliards d’euros à 165 milliards d’euros vingt ans plus tard. Autant l’économie industrielle était irriguée par le rail, autant celle de la consommation l’est par la route, « le bitume et le camion remplacent la locomotive ». Les entrepôts « Amazon » surgissent à la périphérie des villes en cathédrales du XXIe siècle, pendant que les ronds-points deviennent les agoras de la colère, comme l’ont révélé les « Gilets jaunes ».
Loisirs, parcs d’attractions et recompositions touristiques
Et quand la production ne fait plus vivre, c’est le spectacle qui prend le relais. Disney n’est que la tête d’affiche d’un réseau de parcs de loisirs qui reconfigure les équilibres locaux. A Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, le Zoo Parc de Beauval, avec ses deux millions d’entrées annuelles attire plus de visiteurs que Chambord. Une commune de 5 000 habitants avec huit hôtels, « tous propriétés de la famille propriétaire de Beauval, on est en circuit court ! » et 550 offres de logements Airbnb. Depuis leur prêt par la Chine en 2012, les pandas y jouent les VRP territoriaux et drainent le flux touristique, entraînant dans leur sillage le château de François 1er : « le président de l’Office de tourisme du Loir-et-Cher ou celui du Conseil départemental ont intérêt à se soucier de l’état de santé des pandas car ils sont devenus la poule aux d’or du département ! ». Dans d’autres régions, le Puy du Fou, le Futuroscope ou le PAL ne sont plus des curiosités mais bel et bien des locomotives économiques, parfois les dernières en ces terres d’exil industriel.

France désirable et France invisible, France « Triple A » et France « Backstage »
Mais toutes les communes ne bénéficient pas de cette renaissance touristique ou résidentielle. A partir d’une étude pionnière sur les consultations Wikipédia des 35 000 communes françaises, les sondeurs ont pu établir une cartographie inédite de la « désidérabilité territoriale ». Avec pour résultat deux « France » qui se dessinent : la France « Triple A", instagrammable et convoitée, celle des littoraux, des montagnes, des centres-villes métropolitains et la France « Backstage », celle qui ne fait pas rêver, celle qu’on contourne sur l’autoroute des vacances. Loin d’un fatalisme stérile, Jérôme FOURQUET met des mots et des cartes sur ces déséquilibres, révélant comment la crise du logement, le télétravail ou la course au soleil recomposent les flux résidentiels et renforcent les inégalités spatiales. Pour ces territoires de « relégation », le défi est immense : rester visible, dans une France où l’attention est désormais un capital rare.
Et les cultures régionales dans tout cela… ?
Accents, pratiques culinaires, attachement au terroir… Autant de marqueurs des cultures régionales françaises, mis à l’épreuve par la mobilité croissante des populations, l’homogénéisation des modes de vie et le poids des transformations économiques et culturelles. Parmi les premiers marqueurs culturels régionaux, l’accent reste un indicateur puissant, « d’après une enquête IFOP, seuls 20 % des Français déclarent avoir encore un accent régional marqué, moins de 10 % en Ile-de-France, dans le Centre et l’Ouest où l’homogénéisation linguistique est déjà largement accomplie… ».
Certaines zones périphériques en revanche, comme le Pas-de-Calais, l’Alsace et surtout, la région Midi-Pyrénées, affichent encore fièrement leur phrasé régional. Et si l’on superpose cette carte des accents à celle des clubs de rugby de l’Ovalie, la correspondance saute aux yeux, « et d’ailleurs, ça ne vous a pas échappé, si vous regardez un match à la télé, ceux qui commentent n’ont pas un accent picard ! ».
La culture régionale s’exprime aussi dans l’assiette : là où dans les années 30, selon le « cadastre lipidique » de la France réalisé à l’époque, le saindoux s’imposait au Centre, le beurre dans l’Ouest et le Nord, l’huile d’olive au Sud, une enquête récente montre à quel point la donne a changé : le saindoux a disparu, « il y a un grand ouf de soulagement dans le corps médical ! » et l’huile d’olive est majoritaire, que ce soit dans le nord de la Loire ou, sacrilège ultime, en Loire-Atlantique et dans les Côtes d’Armor, « bientôt des crêpes à l’huile d’olive ! ». Les pratiques alimentaires régionales se standardisent, tirées par la grande distribution, mais aussi les nouvelles normes de santé, d’écologie ou de consommation. La mondialisation douce de la poêle et des casseroles est en marche !

La sédentarité en recul : le « grand déménagement »
Le facteur central dans la dilution des cultures régionales reste la mobilité. Depuis les années 70, la France a connu un grand déménagement intérieur. En comparant lieu de naissance et lieu de décès, on observe une chute vertigineuse du nombre de « natifs » disparaissant dans leur département d’origine. Là où en 1972, plus de 80 % des décédés en bretagne ou dans le Massif Central, étaient nés sur place, cette part est aujourd’hui tombée sous les 60 % et parfois bien plus bas. Résultat : des pratiques et des cultures qui s’affadissent au profit d’un mode de vie standardisé. Avec pour symbole inattendu de cette rupture, l’essor de la crémation.
Encore marginale à l’aube des années 80 (0,9 % des obsèques), elle concerne aujourd’hui 45 % des funérailles, atteignant même 70 % à Nice, où nombre de retraités ont « émigré » du Nord ou de l’Est. Un changement brutal reflétant l’éclatement des liens familiaux et territoriaux mais également la perte de repères traditionnels notamment religieux : « le déclin du catholicisme, vous pouvez facilement le mesurer par l’évolution de la part de marché du prénom Marie sur les naissances féminines, 20 % en 1900, contre 0,3 % aujourd’hui… ». Avec pour corollaire, un nombre de prénoms à consonance musulmane atteignant aujourd’hui 21 % des naissances contre à peine 1 % en 1960, l’époque bénie des « Trente glorieuses », où l’on commençât à faire appel à une main d’œuvre immigrée pour rebâtir la France, faire tourner les mines et les usines : « et donc bien évidemment, l’audience qui va être prêtée aux partis qui ont fait de l’immigration, l’alpha et l’oméga de leur discours politique, ne va pas être la même, selon qu’on habite sur la façade Ouest ou dans la partie Est du pays, plus concernée par le sujet… ».
Alors que la France semble glisser vers une uniformisation culturelle, des signes montrent que les cultures régionales, sans être épargnées, n’ont pas disparu. Elles se recomposent, mutent, se déplacent…. Elles ne sont peut-être plus dominantes, mais continuent d’irriguer l’imaginaire collectif, défiant le rouleau compresseur de l’homogénéisation. La diversité est sous pression mais n’a pas dit son dernier mot !
Fin de la première partie
Dominique BERNERD